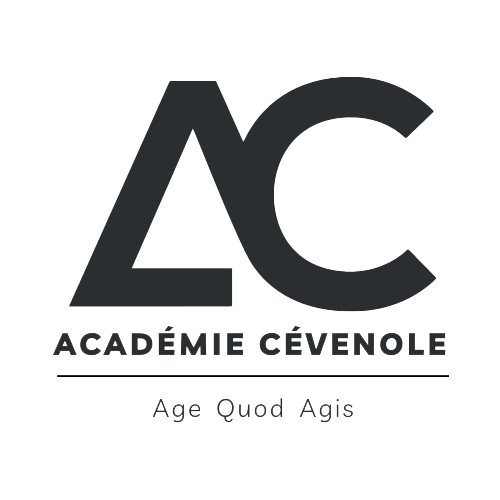« Résistance et fraternité : Cévennes 1940-1945 » est un roman de Daniel Flamant, paru le 11 février 2025 , aux éditions La Cause.
Dans Résistance et fraternité : Cévennes 1940-1945, Daniel Flamant plonge le lecteur au cœur de la Seconde Guerre mondiale dans les Cévennes. À travers les actions de résistants et la solidarité des habitants, ce roman historique raconte des épisodes de courage, de fraternité et de survie face à l’occupation. Il présente notamment à travers la vie et les amours d’une équipière de la CIMADE naissante, l’accueil et le soutien apporté aux Juifs, et plus largement aux réfugiés et exilés, dans les Cévennes pendant la deuxième guerre mondiale.
Daniel Flamant, journaliste de formation, a enseigné, pour des adultes, autour de l’écriture et de la parole. Passionné par l’histoire locale et la mémoire des territoires, c’est donc logiquement qu’il s’est lancé dans l’écriture Son travail s’attache à retracer des épisodes marquants du passé à travers des recherches documentées et des récits accessibles au grand public. Il s’intéresse particulièrement aux figures et événements qui ont façonné les Cévennes.
Avis de lecture :
Mathis Orlandini, nous livre son avis sur, « Résistance et fraternité : Cévennes 1940-1945 » de Daniel Flamant, paru le 11 février 2025 , aux éditions La Cause.
Ce qui m’a profondément intéressé dans Résistance et fraternité de Daniel Flamant, c’est la manière subtile dont l’auteur articule la fiction et l’histoire réelle, en offrant plusieurs niveaux de lecture qui enrichissent la compréhension du récit. Le lecteur navigue ainsi entre trois dimensions complémentaires. La première est celle de l’Histoire nationale : les grands événements de la Seconde Guerre mondiale, connus de tous, forment le cadre général du roman. Ces repères historiques permettent de situer l’intrigue dans un contexte large, tout en soulignant l’ancrage documentaire du livre.
La deuxième est celle de l’histoire locale, centrée sur la résistance dans les Cévennes. Ce niveau, plus spécifique, donne à voir une mémoire enracinée, souvent méconnue, à travers des faits, des lieux et des figures propres à la région. Daniel Flamant restitue avec justesse l’atmosphère des villages, des maquis, des parcours individuels et collectifs dans cette zone singulière. L’ancrage géographique est d’ailleurs particulièrement précis : les localisations sont détaillées, et une carte en début d’ouvrage permet au lecteur de mieux suivre les déplacements des personnages dans ce paysage cévenol.
Enfin, la troisième dimension est celle de la fiction, portée par les personnages que l’on suit tout au long du récit. Le lecteur s’attache à leurs choix, leurs doutes, leurs élans de solidarité et leurs engagements parfois silencieux, mais toujours profondément humains. C’est cette articulation entre les niveaux historique, local et intime qui donne toute sa profondeur au roman.
Un autre aspect qui m’a particulièrement touché est l’angle choisi par l’auteur pour évoquer la Résistance. Il ne s’agit pas ici des grandes figures héroïques, ni des actions spectaculaires ou des actes de sabotage mis en avant dans de nombreux récits. Flamant préfère raconter une autre forme de courage : celui du quotidien, de la discrétion, de l’engagement humble mais constant. Il met en lumière une « résistance silencieuse », faite d’accueil, de solidarité, de désobéissance morale et de fraternité.
Ces gestes ordinaires prennent une dimension héroïque précisément parce qu’ils sont portés par des individus anonymes, sans quête de reconnaissance. Le roman donne également une place essentielle aux femmes, en particulier aux “équipières” protestantes de la Cimade, qui jouent un rôle central dans l’aide aux réfugiés et persécutés. Cette attention portée à la résistance féminine, souvent oubliée dans les récits mémoriels, est l’un des points forts du livre.
Enfin, Résistance et fraternité résonne profondément avec l’histoire protestante des Cévennes, elle-même marquée par les persécutions passées. Il y a une comparaison, pas explicite, entre les résistances du XVIIIe siècle (celle des Camisards) et celles de la Seconde Guerre mondiale. Le roman explore ce lien en creux, en montrant comment une culture religieuse de minorité peut engendrer une éthique de solidarité et de résistance morale.
Mathis Orlandini, élève à l’ENA